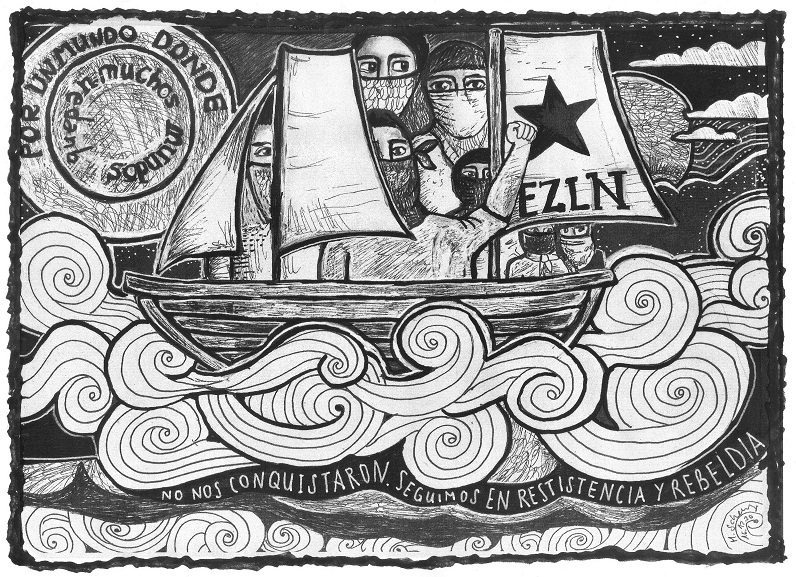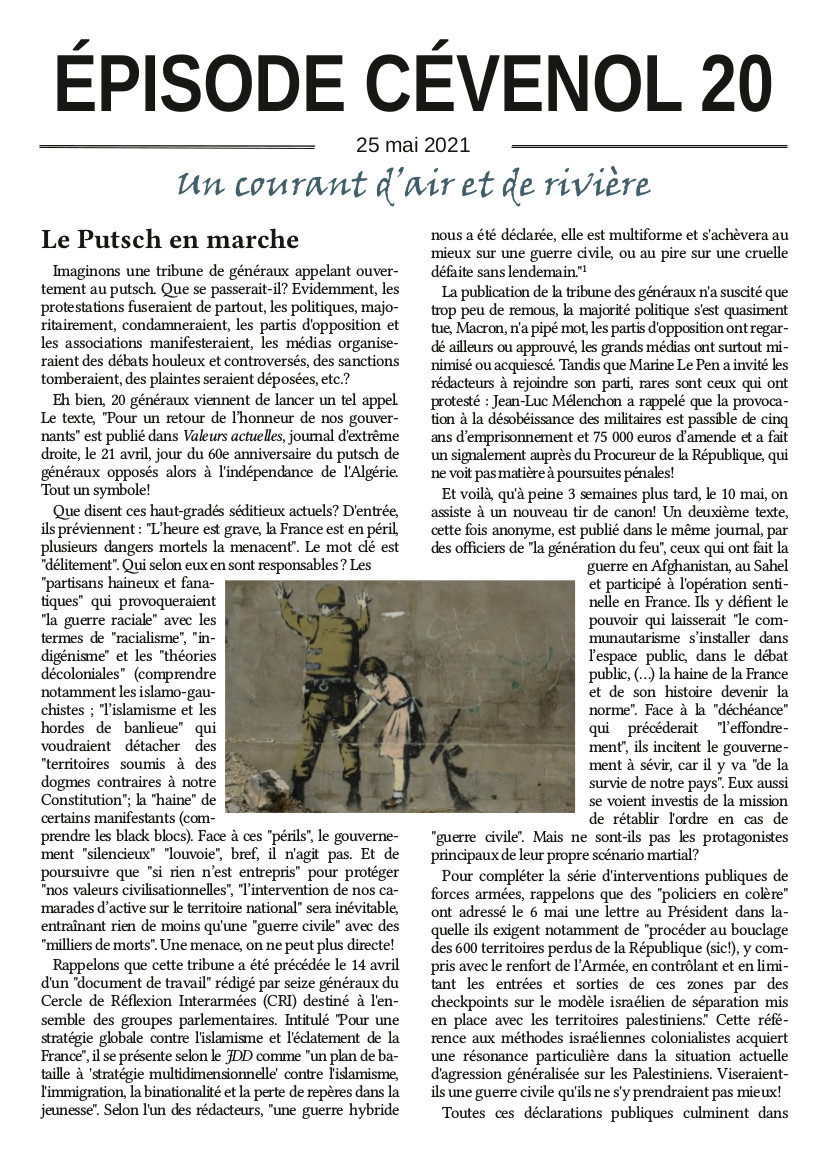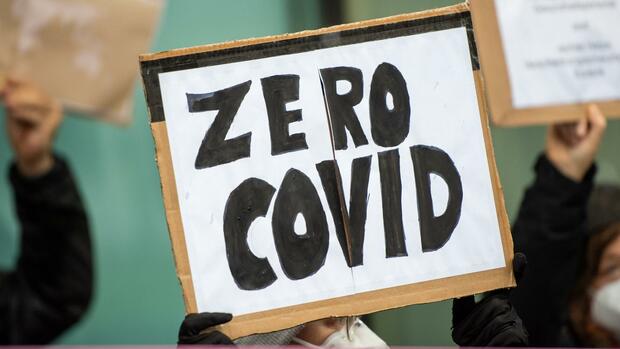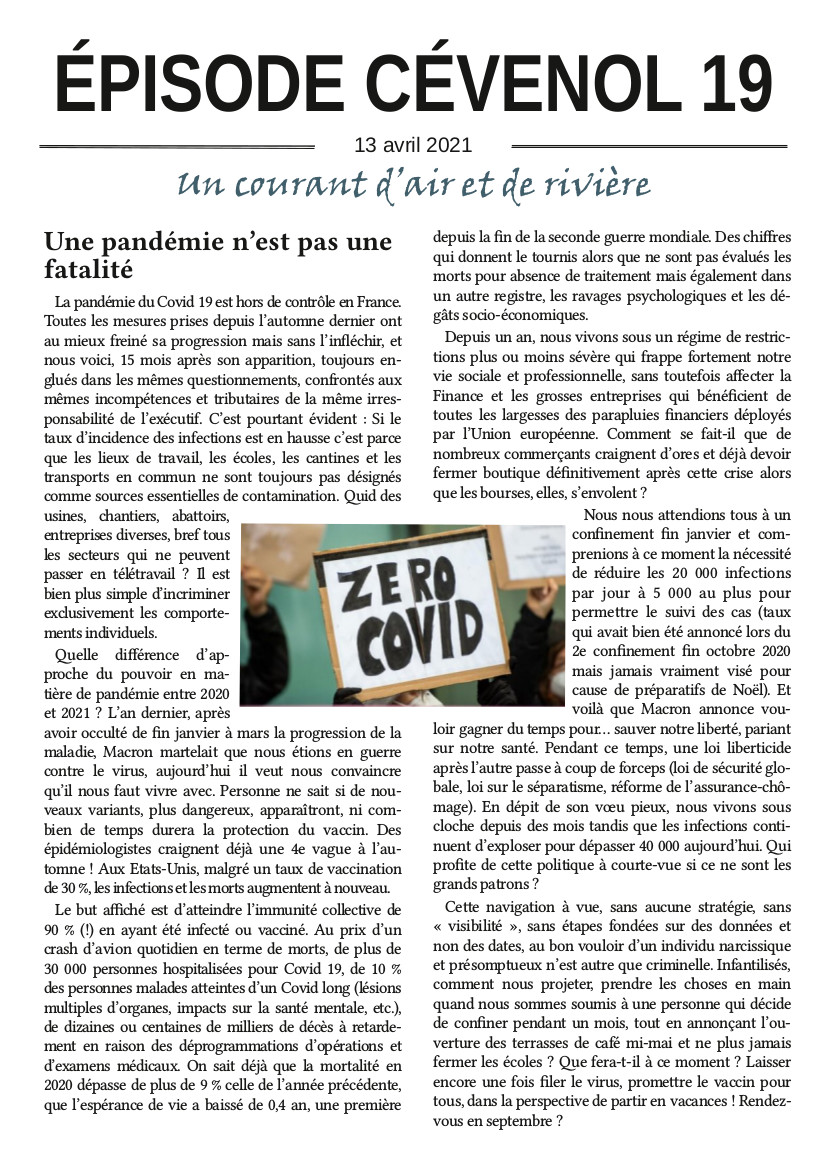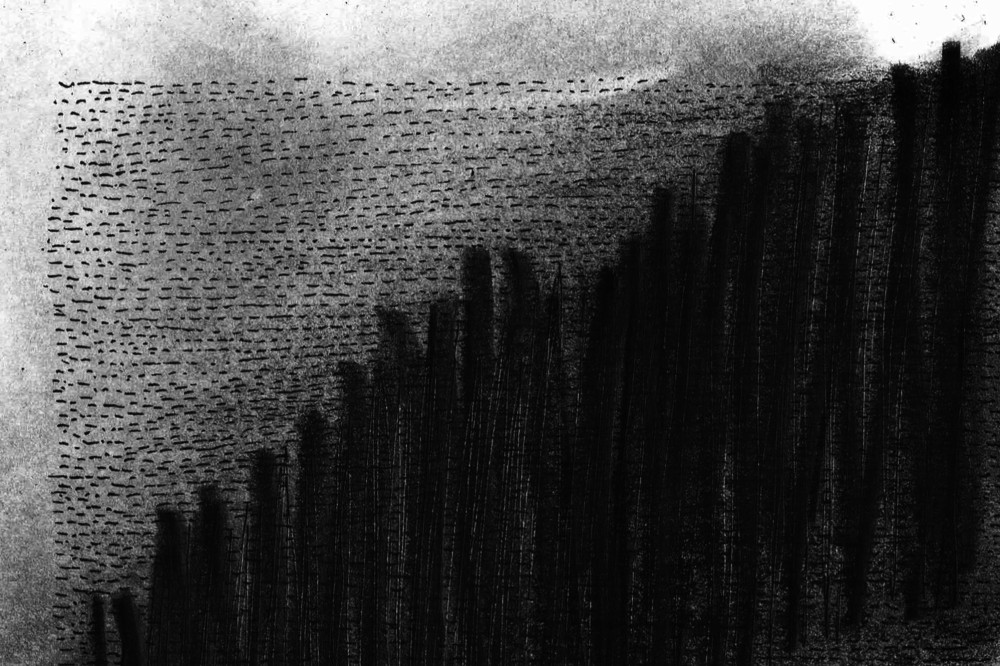Article paru dans l’Épisode cévenol numéro 20.

Parmi les figures classiques de la rhétorique des partis d’extrême droite et des mouvements populistes, se dresse en bonne position le lien fantasmé du fait migratoire au phénomène terroriste. Cette corrélation, si elle est allègrement reprise et relayée par une large sphère médiatique aux lendemains d’attentats, relève également de constructions politiques profondément ancrées dans nos sociétés. Comprendre les déclarations anti-immigration tenues par de nombreuses personnalités politiques à la suite des récentes attaques de Conflans-Sainte-Honorine et Rambouillet requiert alors de replacer ce type d’amalgame fallacieux dans un contexte plus large.
L’immigration a de longue date été définie comme menace et source d’instabilité. De la « montée du chômage » à l’« insécurité dans les banlieues », du « délitement de l’identité nationale » au « communautarisme », c’est bien le spectre de l’immigration qui est brandi pour justifier de nombreuses questions structurelles en panne de solution politique et qui légitime des réponses d’ordre sécuritaire. Que se soit à l’échelon européen comme au niveau national, « les registres sécuritaires de la lutte contre le terrorisme et de la lutte contre l’immigration clandestine se trouvent totalement imbriqués tant dans les représentations et les discours que dans les politiques publiques »1. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, la tendance que suivent les États de « fermer les frontières nationales pour se sentir plus en sécurité sur le territoire souverain, convaincu que la menace terroriste vient d’ailleurs. »2, renforce encore les discours sur la peur de l’immigration.
Cette « gouvernementalité par l’inquiétude » permet alors de passer outre les évidences les plus élémentaires, et les propos évoqués servent des intérêts politiques particuliers plutôt qu’une réelle volonté de cerner et de remédier à un problème donné. Ainsi, qu’une chercheuse au CNRS, spécialiste des migrations, rappelle que si l’on ramène les plus de 250 000 entrées légales et illégales par an au nombre d’attentats ou de tentatives d’attentats impliquant des personnes de nationalité étrangère, le résultat demeure « complètement marginal statistiquement », ne semble guère suffire à faire tomber le préjugé3. Qu’une étude récemment menée croisant les informations disponibles sur les flux migratoires dans 145 pays, entre 1970 et 2000, conclue qu’il n’existe pas de lien de cause à effet entre immigration et terrorisme, ne permet guère de contrer des propos infondés non plus4.
Ainsi, force est de constater que l’immigré est jugé non pour ce qu’il est, mais pour ce qu’il représente. Cette stigmatisation touche d’ailleurs aussi bien l’étranger « qui vient pour moins de trois mois dans un pays européen que l’enfant ou le petit-fils de quelqu’un qui s’est installé dans le pays il y a plus de quarante ans »5. Ce parti pris assimile de fait des populations entières à une identité présumée (communauté tchétchène, musulmans, « seconde génération » d’immigrés…), tenues responsables ou suspectées de nombreuses déviances. Si ce dangereux conditionnement de l’opinion publique par le politique demeure épisodiquement dénoncé par quelques défenseurs des droits l’homme et associations antiracistes, il n’en demeure pas moins problématique à bien des égards. Notamment en ce qu’il permet d’occulter tout débat et toute analyse contradictoires qui envisageraient des perspectives qui n’iraient pas dans le sens des discours politiques dominants ou qui rappelleraient des responsabilités institutionnelles sur la question.
Partant de là, les rapports rédigés par les anthropologues, démographes, économistes, sociologues, politistes établissant des liens de causalités et des éléments de compréhension avérés sur les facteurs concrets favorisant l’émergence du terrorisme et de la radicalisation passent alors au second plan – quand ce n’est pas à la trappe, happés par le feu médiatique de démagogues souvent racistes et xénophobes. Il devient alors aisé d’omettre le rôle qu’ont pu jouer les puissances occidentales dans l’implantation et l’émergence de groupes djihadistes lors de certaines interventions militaires6, les résurgences d’un passé colonialiste trop vite oublié, ou les conséquences des guerres prétendument nommées « anti-terroristes ». Les études réalisées par l’Observatoire contemporain du terrorisme, de l’antiterrorisme et des violences (OCTAV) montrent en cela l’absolue inefficacité de ces dernières quant aux finalités dont elles sont dotées et avancent que le phénomène est celui du « pompier pyromane » : loin de combattre le terrorisme, il l’alimente en nourrissant le ressentiment7.
Pour autant, la politique menée depuis des années et sur-alimentée récemment par les multiples lois anti-immigration, discriminatoires et sectaires ne font que renforcer un climat de suspicion stérile et accroître les potentialités de passage à l’acte terroriste et la radicalisation. Les théories fascisantes du « grand remplacement », les débats sur le séparatisme, où les déclarations tenues au plus haut sommet de l’État français ciblant particulièrement les populations immigrées de confession musulmane ne peuvent ainsi qu’engendrer crispations et exclusions, là où une acceptation de l’altérité apporterait une solution. Comme l’indique un politologue spécialiste de l’islam politique : « Nous fabriquons ces individus qui choisissent – parmi de très nombreuses autres possibilités – une expression binaire, clivante et totalisante de leur appartenance religieuse. Le recours à la violence sectaire fait donc suite à des dysfonctionnements majeurs du vivre ensemble européen ou oriental qui poussent ces individus à la rupture. »8 Ainsi, plutôt que de chercher à combattre le terrorisme, mieux vaudrait commencer par cesser de le créer.
[Grenouille]
1Vincent Geisser, « Immigration et terrorisme : « corrélation magique » et instrumentalisation politique », Migrations Société – 2020 n°182
2Estibaliz Jimenez, « Pourquoi l’immigrant est-il perçu comme une menace pour la sécurité nationale ? », Questions de criminologie – 2010
3Catherine Withol de Wenden, citée dans : « Existe-t-il un “lien entre immigration et terrorisme”, comme l’affirment certains politiques de droite et d’extrême droite ? », France Info – 5 mai 2021
4Voir notamment : « Une nouvelle étude démontre que l’immigration ne favorise pas le terrorisme », Slate – 18 février 2016
5Didier Bigo, « Sécurité et immigration : vers une gouvernementalité par l’inquiétude ? », Cultures & Conflits – Printemps été 1998
6A ce sujet, lire : « L’occident et les Djihadistes : Chronique d’une hypocrisie », Acta Zone, 24 octobre 2020
7Voir notamment : « Guerres et terrorisme : sortir du déni », Nouvelobs – 14 novembre 2020
8François Burgat, « Il ne s’agit pas de combattre les jihadistes mais d’arrêter de les fabriquer », Libération – 4 novembre 2016